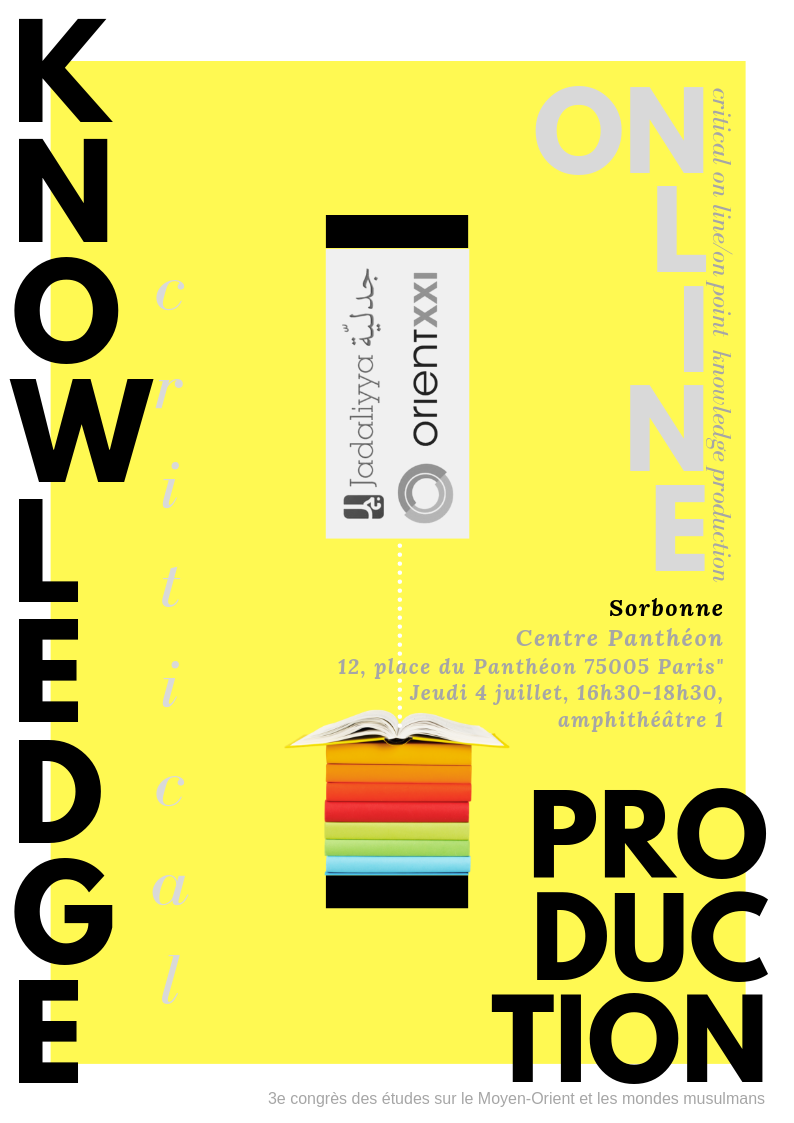[This piece is part of a roundtable held in Paris last July at the 4th GISMOM Conference (July 2019) of the French network on the study of the Middle East and the Muslim World. This panel included lectures by Cihan Tekay, Muriam Haleh Davis, Thomas Serres, Bassam Haddad, Alain Gresh, and was organized by Eric Verdeil. All lectures from the panel will be posted in the coming weeks.]
Ce texte parle non pas du futur, mais plutôt des attentes et des craintes par rapport au futur et de leur place dans la production de savoir sur les sociétés du Maghreb. Il se concentre sur le cas de l'Algérie, mais la question ne se limite pas au cas algérien. Par exemple, en Tunisie, fin juin 2019, la dégradation rapide de la santé de Caïd Beji Essebsi et la perspective de l'élection présidentielle ont suscité une anxiété palpable. Les voyages et les problèmes de santé de Mohammed VI nourrissent aussi les interrogations au Maroc. Au-delà du Maghreb, la situation au Yémen, en Egypte, en Syrie se passe de commentaire. Quoi qu'il en soit, ces sociétés font face à de grandes incertitudes politiques, économiques et sécuritaire. Dans ce contexte, je crois que l'Algérie, à cause de la décennie noire et des caractéristiques du règne de Bouteflika (comme moment de reconstruction et de stabilisation après le chaos absolu), a valeur d'exemple paradigmatique.
La catastrophe suspendue
L'une de mes obsessions, si l'on peut dire, sur quoi j'ai déjà pu écrire par le passé pour Jadaliyya ou pour des publications plus académiques, c'est l'idée selon laquelle l'Algérie a été confrontée depuis la fin de la décennie noire à une forme de catastrophe suspendue. Ceci peut se décomposer de la manière suivante :
- la vie politique du pays a été largement conditionnée par l'idée socialement partagée selon laquelle une montée de la violence était toujours possible, et même parfois imminente ;
- cette idée socialement partagée était basée sur des discours et sur des phénomènes bien réels (terrorisme résiduel, émeutes récurrentes, fragilité économique, tensions communautaires) ;
- elle a servi de socle à un système de gouvernement qui devait réinscrire l'Algérie dans un continuum du développement, avec une vision très sécuritaire et disciplinaire de ce que développement peut vouloir dire ;
- c'est le « gouvernement par catastrophisation » que je décris dans L'Algérie face à la catastrophe suspendue.
De manière générale, la catastrophe suspendue était synonyme d'une forme de crise permanente et d'un péril existentiel à différents niveaux : la nation, le régime, les organisations politiques, les individus. Elle allait aussi de pair avec une multiplication de non-événements qui ne changeaient pas fondamentalement la trajectoire du processus critique, en tout cas jusqu'à ce que l'événement décisif ait finalement lieu au mois de février dernier. Ces non-événements étaient le produit de différents facteurs (conspirationnisme, attentes des observateurs, formes de sociabilités, contexte politique). Mais pour faire simple, on peut dire qu'ils correspondaient à l'annonce d'une disruption imminente et particulièrement intense, d'un virage décisif (un soulèvement, un coup d'État, une crise économique majeure). Or cette disruption n'avait pas lieu à l'heure dite.
Alors comment travailler sur le non-événement ? Comment réfléchir à ce que le futur veut dire dans une société confrontée à un péril existentiel permanent, et gérée grâce et par la catastrophe suspendue ? On peut distinguer deux niveaux : d'abord l'approche purement sociologique, empirique, scientifique, qui consiste à se situer au niveau des acteurs, afin de comprendre leurs calculs, leurs anticipations, et leurs stratégies ; ensuite la question de la compréhension de la trajectoire, de l'analyse des potentialités, une question piège, bien sûr, mais aussi éminemment politique. En effet, ces projections dans le futur servent de cadres analytiques pour produire des diagnostics sur la société. Promouvoir une vision catastrophiste de la trajectoire algérienne, c'est ainsi souvent promouvoir un certain type de savoir sur la société qui va dans le sens de certaines politiques.
Les agendas politiques
Prenons trois exemples d'agendas politiques liés à la production d'un savoir catastrophiste sur l'Algérie, même si il y a une part d'arbitraire dans cette catégorisation.
D'abord, on a tout le système de production de savoir lié à l'État algérien, et particulièrement à ses organes sécuritaires, qui ont fourni pendant des années une base statistique, wilaya par wilaya, afin d'amalgamer toute forme de contestation à de l'émeute. En parallèle, les discours officiels tout comme les officines liés à une fraction du régime ont produit une image paranoïde et paternaliste de l'Algérie qui cadrait bien avec l'orientation sécuritaire de la vie politique. Le peuple était présenté comme immature, impatient et manipulable. Le voisinage immédiat était dépeint comme porteur d'innombrables menaces, liés notamment aux manipulations de la « main de l'étranger ». Ainsi, l'État a produit une représentation d'un futur menaçant qui justifiait sa nature policière.
Mais les discours catastrophistes sur l'Algérie ne servaient pas qu'à légitimer le gonflement des effectifs de polices. La catastrophe suspendue n'était pas uniquement une question d'éviter la répétition de la guerre civile. Il s'agissait aussi d'éviter l'effondrement économique des années 1980-1990. De ce point de vue, notons que le savoir produit par les élites économiques et libérales (par exemple dans le cadre des think-tanks associant chef d'entreprises et économistes comme Nabni ou Care) s'est emparé du thème de la catastrophe pour mieux pousser en faveur de réformes économiques d'inspiration néolibérale.[1] Depuis près de 10 ans, ces acteurs produisent leur propres rapports, avec leurs propres recommandations, qu'ils diffusent de manière relativement efficace dans la presse privée et sur les réseaux sociaux.
Troisième lecture du futur, troisième manière de penser la catastrophe suspendue politiquement, celle des élites culturelles, qui s'intéressaient de manière plus aiguë à la question identitaire, religieuse, et culturelle, et c'est somme toute assez logique. La catastrophe suspendue était alors lue au prisme d'une soi-disant maladie culturelle, qui pouvait résulter d'une tension irrésolue entre tradition et modernité, ou d'une culture islamique soit-disant pathologique. Le thème de la pathologie culturelle est apparu très tôt en Algérie, et occupaient les esprits de figures très différentes. Malek Bennabi ou Kamel Daoud ont abordé ce sujet en des termes très différents, avec des entrées et des objectifs distincts. Pourtant, le fond de l'agenda reste le même : pour mettre fin à la crise du pays, au conflit identitaire, à la schizophrénie postcoloniale, il fallait faire une révolution culturelle et éduquer le peuple.
Bien sûr, ces compréhensions de la catastrophe algérienne circulent en lien avec l'extérieur, avec les médias étrangers, les gouvernements alliés, les institutions partenaires. Le discours sécuritaire du gouvernement algérien est reproduit par ses alliés européens, qui partagent les objectifs en terme de contrôle des populations. Le discours de l'urgence économique est reproduit et disséminé par les bailleurs étrangers, à commencer par le FMI et l'UE qui travaillent avec les think-tanks libéraux algériens. Enfin, le discours de la pathologie culturelle trouve un écho dans les médias occidentaux, et tout particulièrement en France, parce qu'il fait écho à une certaine imagerie morbide orientaliste et à l'islamophobie omniprésente.
Que Faire ?
Alors, quelle peut être notre position, en tant que chercheurs, ou qu'experts, dans un contexte où des discours catastrophistes circulent en permanence ? Il est vrai que nous avons été formés à la méfiance. Il ne faut jamais, ô grand jamais, parler du futur. On ne fait pas de recherche sur ce qui n'a pas eu lieu. Pour autant, je ne crois pas que ne rien dire à propos du futur soit une possibilité.
D’abord, j'ai appris à mes dépens que la fascination des journalistes et du public pour l'anticipation fait que l'on vous fera dire quelque chose même si vous essayez de ne rien dire. C'est la règle du jeu de l'intervention dans l'espace public. Ensuite, il est plus que probable qu'un ouvrage, aussi excellent soit-il, qui décrit un moment dans l'histoire du pays, se retrouvera sous le feu de la critique pour ne pas avoir prévu quelque chose d'imprévisible. Je pense notamment à certaines critiques que j'ai pu entendre à l'égard de La force de l'obéissance de Béatrice Hibou en 2011-2012. Par ailleurs, durant une période de crise, la production d'analyses de la trajectoire répond à une nécessité politique. Comprendre la trajectoire, c'est permettre à la fois un effort de diagnostic et de résolution des maux à l'origine du péril existentiel. C'est aussi ramener de l'intelligibilité pour pouvoir penser le futur en-dehors du cadre imposé de la catastrophe. Finalement, puisqu'il est acquis que les discours catastrophistes participent de stratégies médiatiques et politiques qui produisent de l'aliénation, en Algérie et à l'étranger, il semble nécessaire de s'essayer à la réinformation.
D'où la nécessité de produire des contre-discours. Avant 2019, plusieurs collègues ont souligné la nécessité de sortir du catastrophisme qui paralysait l'analyse en Algérie, et qui servaient un certain nombre d'agendas sécuritaires, néolibéraux et culturalistes.[1],[2] Arriver à une compréhension post-catastrophiste de l'Algérie, cela pourrait vouloir dire que l'on s'essaye d'une certaine manière au wishful thinking. Mais cela peut aussi tout simplement impliquer que l'on porte le regard sur des choses simples, relativement joyeuses, et casser le récit hégémonique et menaçant de la catastrophe suspendue. Avant le 22 février, on pouvait aussi d'une certaine manière se concentrer sur la situation révolutionnaire algérienne, sur ce que le quotidien avait d'insupportable, sur l'illégitimité du régime, et ainsi laisser la possibilité d'une ouverture des possibles, ne jamais insulter le futur en quelque sorte. C'est ce que j'ai essayé de faire dans les articles que j'ai publié sur Jadaliyya (ici, là ou encore là), sans bien sûr prétendre avoir anticipé ce qui s'est passé en février à aucun moment.
Après le Hirak
Finalement, il me faut bien conclure avec le Hirak, et ce que cela a changé. Ici, bien sûr, je parle sans recul, mais disons que j'ai le sentiment d'être passé par trois phases de l'analyse. Il y a eu d'abord cette phase d'enthousiasme pur, dans les deux premiers mois du Hirak, qui correspondait à la réalisation du rêve d'une sortie de la crise par le haut, où tous les pronostics catastrophistes étaient déjoués. Puis, depuis la fin avril, un contre-coup, une critique du côté « bisounours » pour reprendre le terme d'un ami, avec en fond l'idée qu'il y a des éléments pragmatiques à prendre en compte (notamment la fameuse « formulation de l'alternative »). Et enfin, la troisième phase, celle dans laquelle beaucoup d'entre nous se trouvent depuis la mi-juin, celle du retour à un état d'inquiétude intense, à la faveur de la montée en puissance de Gaïd Salah et de l'intensification de la répression.
Dans ce contexte, force est de constater que le catastrophisme demeure. L'idée qu'une sortie de crise par le haut était sans doute trop belle, symptôme de l'enivrement qu'apporte l'enthousiasme révolutionnaire dans ses premiers mois, surtout quand cela se passe sans violence comme cela a été le cas en Algérie. Pour autant, nous savons que le catastrophisme ne permet pas une description juste de la situation. Il répond à un certain nombre de préjugés et il sert la répression policière et les réformes néolibérales.
Il faut donc combattre le catastrophisme en étant réaliste. Il faut être positif sans être post-factuel. Il faut sans cesse rappeler dans l'espace public que l'Algérie n'est pas vouée au gouvernement sécuritaire et à l'économie de prédation. Depuis bien avant le Hirak, des milliers d'Algériens mobilisés ont démontré que les possibilités du pays allaient bien plus loin que cet horizon de la catastrophe suspendue, du règne de l'armée, de la bureaucratie, et de la police. Contre la démonstration de force collective et d'espoir débutée en février dernier, le cœur de l'état tente de se maintenir coûte que coûte. Ses partenaires étrangers ferment les yeux. Les médias occidentaux se préoccupent plus d'islamisme que de souveraineté populaire et de justice sociale. C'est une bonne raison d'écrire, dès que nous le pouvons, sur Jadaliyya et ailleurs, pour rappeler que l'horizon de l'Algérie, l'horizon du monde arabe, n'est pas cette crise permanente érigée en mode de gouvernement.
[This piece is part of a roundtable held in Paris last July at the 4th GISMOM Conference of the (the French network of studies on the Middle East and the Muslim World)]
[1] Il y a bien sûr différentes façons d'être néolibéral, et les rapports des membres de Nabni s'inspirent davantage de l'ordolibéralisme allemand dominant au niveau européen que du consensus de Washington ou des imprécations antikeynesienne d'un Milton Friedman.
[2] Voir par exemple Salim Chena, « L'Algérie dans le « Printemps arabe » entre espoirs, initiatives et blocages », Confluences Méditerranée 77, no. 2 (2011), 105-118 or Walid Benkhaled & Natalya Vince, « Performing Algerianness: The National and Transnational Construction of Algeria’s ‘Culture Wars’ », in Algeria : Nation, Culture, and Transnationalism 1988- 2013, Patrick Crowley ed. (Liverpool: Liverpool University Press, 2017), 243-270.
______________________________